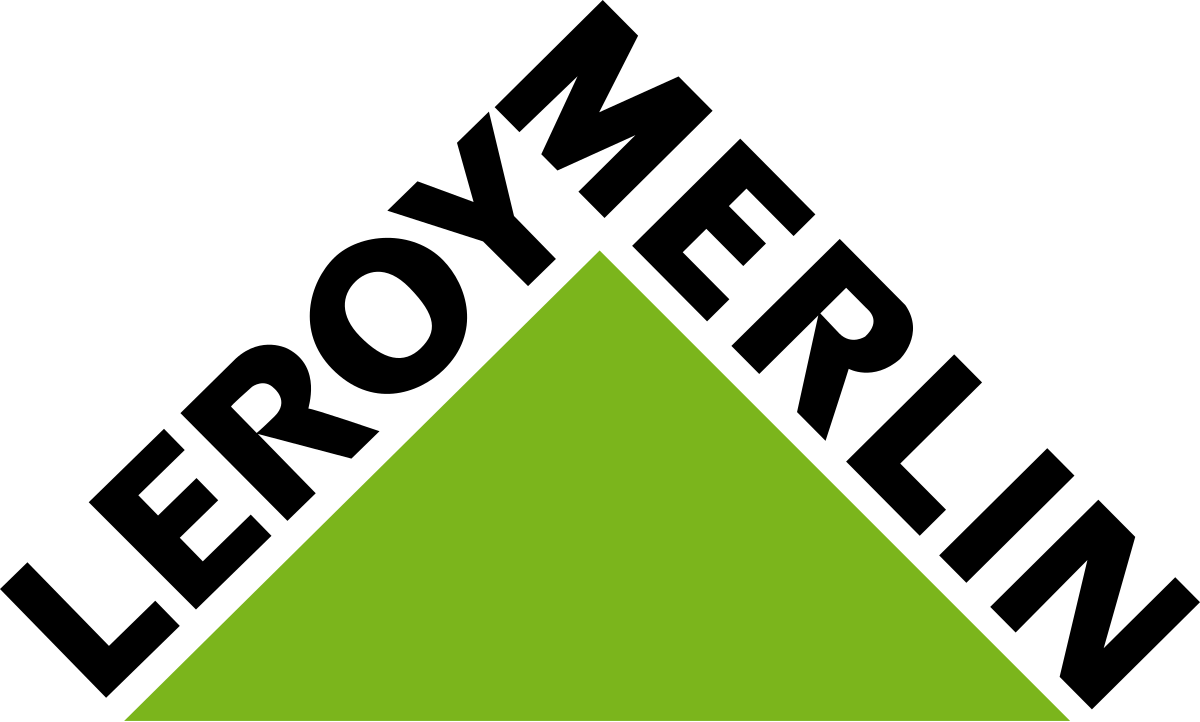A la suite de l’annonce du Président de la République concernant les nouvelles mesures visant à limiter la propagation du coronavirus, les Français sont amenés à se confiner pour éviter de nouvelles contaminations. Pourtant, cette quarantaine forcée n’est pas sans conséquences : elle influe sur les conditions de santé psychologiques et physiques des individus.
Que sait-on des conséquences psychologiques et physiques du confinement chez les Chinois ?
Un exemple actuel témoignant des effets du confinement sur des individus est celui de la Chine, pays dans lequel la crise sanitaire actuelle s’est déclarée.
La Chine a été le premier pays à mettre en quarantaine ses citoyens pour éviter l’aggravation de l’épidémie. Grâce à un auto-questionnaire en ligne, mené dans 36 provinces chez plus de 50 000 personnes, les chercheurs ont pu découvrir que pour 35 % des répondants, soit près d’un tiers, les résultats montrent une augmentation du stress. Pour 5% d’entre eux, ce stress induit des conséquences sévères, avec des impacts physiques comme l’apparition de douleurs articulaires, des maux de tête, ou encore de la tachycardie et des troubles gastro-intestinaux. Ce stress psychologique est associé à plusieurs notions, comme l’anxiété et l’angoisse pouvant survenir chez des personnes lorsqu’on modifie l’environnement dans lequel elles ont l’habitude d’évoluer au quotidien. La frustration, l’absence de visibilité sur l’avenir, sont aussi des aspects à mettre en lien avec ce stress.
D’après cette étude, ce stress concernerait particulièrement les femmes, les travailleurs migrants et surtout les jeunes de 18 à 30 ans, ou les personnes de plus de 60 ans, en particulier dans les zones les plus touchées par l’infection.[1] (Résultats d’une enquête, 06 mars 2020)
Pourquoi le confinement génère-t-il un stress ?
Le stress associé au confinement peut avoir plusieurs origines, telles que :
- La peur de
contracter l’infection elle-même. A noter que le stress est décuplé lorsqu’il
s’agit d’une infection inconnue, comme cela est le cas pour le Covid-19 :
les individus ne pouvant pas se constituer de représentations sur la base de
faits, cela laisse libre court à une multitude d’interprétations qui ne peuvent
pas être contrôlées.
- L’interdit et la
limitation des libertés individuelles : l’individu ne se perçoit plus
comme un sujet libre de ses mouvements et de ses actions. Désormais, son
quotidien lui est dicté par des injonctions légales, ce qui le contraint à
évoluer dans une dynamique à laquelle il n’a pas été préparé.
D’après la revue The Lancet qui s’est intéressée à plus de 3 000 articles publiés sur les conséquences psychologiques du confinement (suite aux épidémies de SRAS, Ebola ou grippe A), plus la durée de confinement est longue (supérieure à 10 jours), plus les risques de symptômes post-traumatiques, de comportement d’évitement ou de colère sont importants.
Dans une méta-analyse parue dans The Lancet, une équipe de chercheurs du King’s College (Royaume-Uni) a passé en revue 24 études détaillant les effets psychologiques de la mise en quarantaine. Ces travaux ont été réalisés dans une dizaine de pays lors des précédentes épidémies : Sars (11 études), Ebola (cinq), grippe H1N1 (trois), et grippe équine (une).
Et leurs conclusions convergent. Les personnes placées en confinement plus de 10 jours ont des symptômes de stress post-traumatique plus importants que celles isolées moins de 10 jours, probablement parce qu’un isolement prolongé finit par engendrer une forme de traumatisme mêlant peur et anxiété. D’autant que les sujets mis à l’écart ont davantage peur pour leur santé ou celle des autres que ceux restés « libres » de circuler : un facteur de stress et d’angoisse supplémentaire.
D’autres facteurs, propres à certains individus accentuent le stress : la grossesse, le fait d’avoir des enfants, les craintes relatives à la distribution des biens de première nécessité, le fait de croire que les informations données ne sont pas suffisamment claires… ces variables ont pour effets d’induire une chronicité dans le stress, qui pourra même perdurer à l’issue du confinement, comme l’indiquent les travaux publiés dans The Lancet.
Face à ce confinement, des mesures de prévention peuvent être prises pour en limiter les effets.
Des recommandations à mettre en œuvre pour faire face aux effets du confinement
Au niveau des activités de télétravail :
- Mettre en place
des outils et des plateformes de travail collaboratif, pour favoriser les
échanges et créer de nouvelles formes de proximité, - Encadrer le
temps de travail des collaborateurs, en régulant les amplitudes horaires de
sorte à ce qu’elles correspondent au temps de travail qui est habituellement
exercé en présentiel - Réguler les
temps de réunions à distance : à distance, la charge mentale de travail
est plus importante qu’en présentiel. Des temps de réunions se limitant à 1
heure en continue permettront de réguler le sentiment de surcharge sur la
journée de travail. - Définir et
suivre un planning de travail quotidien et hebdomadaire
Au niveau des équilibres des temps de vie :
- Dans la mesure
du possible, conserver des instants de pause et de coupure au cours de la
journée de télétravail - Eviter
l’allongement des journées, en conservant le temps dédié aux occupations
familiales et personnelles
Au niveau de la préservation individuelle :
- Se concentrer
sur les faits qui sont présentés par les médias et autres sources
d’informations, de sorte à rester le plus en retrait possible des
interprétations - Identifier les
sources de stress et d’angoisse - Être à l’écoute
des manifestations physiques, émotionnelles, cognitives et comportementales du
stress, pour les réguler et agir sur ses émotions
Toutes les personnes ne seront pas
capables d’éviter la panique et peut être serait-il opportun de réfléchir à des
moyens d’aider les plus fragiles. L’intérêt de mettre en place des cellules
d’écoute psychologique prend tout son sens, ce qui permettra la mise en œuvre
d’une prévention à la fois primaire et tertiaire pour faire face aux effets du
confinement. Gérer et réguler les effets du confinement doivent constituer une
préoccupation de tous les acteurs de la société, y compris au sein des
organisations de travail.
[1] Sources : résultats d’une enquête nationale portant sur le degré de détresse psychologique de la population chinoise suite à l’épidémie de Covid-19 publiée dans la revue spécialisée General Psychiatry le 06 mars 2020